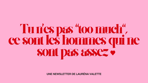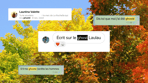5 000 km, du sirop d’érable et des sens
ou mes premiers jours à Montréal.


Lauréna in Loveland
8 min ⋅ 19/03/2023
5 jours, 5 000 km et autant d’émotions ressenties. Derrière chaque personne qui se dit que ça peut être sympa de quitter sa stabilité, son job, sa maison, ses ami.es, sa ville, sa famille, son pays, il y a cette même personne qui fixe le plafond sur un canapé beaucoup trop moelleux, de l’autre côté de l’océan Atlantique, en se demandant pourquoi diable, elle a fait ce choix. Si on pouvait l’observer dans une boule de cristal, on constaterait que cette pensée fera des apparitions, ici ou là, de temps en temps, mais sera très vite remplacée par la joie des nouveautés. La première bouchée d’un vrai donut, le premier écureuil croisé dans le parc, les retrouvailles avec des amie.es, les premiers flocons de neige qui virevoltent dans le ciel. Les premiers moments, des premiers jours, dans un nouvel environnement à apprivoiser. C’est aussi ça, de faire le choix de changer de vie : se laisser du temps. À son corps, de prendre possession des lieux, à sa tête, d’accepter le changement imminent, à ses habitudes, de se défaire de là-bas, pour se recréer ici. Écouter ses sens, les cultiver et prendre soin de son jardin intérieur, car tout bouleversement vient avec son lot de joie, mais aussi avec ses incertitudes et ses peines. Et je crois, que c’est tout ce mélange qui rend vivant.
L’ouïe
Quand j’ai décidé de prendre la route de l’aventure, j’ai écrit à la plus aventurière des personnes qui m’entourent : ma cousine. Etats-Unis, Afrique du Sud, Amérique du Sud, elle n’en est plus à sa première expatriation, je savais très bien quelle serait de bons conseils. Parmi ceux-là, elle m’a raconté avoir des indispensables qu’elle glisse toujours dans sa valise, pour avoir un peu de chez soi, même ailleurs. Des éléments qui réveillent les sens et qui, finalement, envoient au cerveau ce message : “tout va bien, c’est familier”. J’ai donc pris, sans aucune hésitation, mon enceinte portable Marshall. Rien de bien nouveau dans mon quotidien, mais voilà que la musique continue d’habiter les murs du salon. Des playlists folk et indie pour prendre le temps : de manger, de lire, de boire son café, de se reposer. Des mélodies qui étaient déjà les miennes à Paris, qui créent alors la bande son de cette nouvelle vie et ce sentiment, qui ne disparaît jamais : quoi qu’il se passe, il restera toujours la musique. Celle qui est comme une caresse pour le cœur, celle qui câline, qui calme, qui rassure. C’est là toute la beauté de cet art, il s’immisce en toi. Il existe une playlist, un artiste, une chanson, pour chaque moment, chaque émotion ressentie.
L’odorat
Je me souviens très bien du jour où il a glissé sa tête dans mon cou après m’avoir embrassé, et il a annoncé dans un soupir “tu sens bon”. D’autres l’ont dit avant, et après, pourtant cet instant s’est ancré dans ma boîte à souvenirs. Cela fait partie de ces choses auxquelles je ne déroge jamais, sans réellement savoir pourquoi, comprendre d’où ça vient. Peut-être que c’est un mécanisme inconscient pour ne jamais être oublié : maintenant, dès qu’il sentira ce parfum, il pensera à moi. Je m’installe, par l’odorat, dans le paysage des autres. Des flacons de parfum que j’aime, j’en ai plusieurs. J’ai alors dû faire un choix, lorsque j’ai préparé mes valises : lesquels prendre ? J’ai opté pour mes préférés. Quand j’ai ouvert la trousse magique digne d’une influenceuse beauté, contenant tout le nécessaire pour sublimer corps et visage, j’ai cru que le flacon ne fonctionnait plus. Un embout s’était dévissé. Le drame et puis, le soulagement. J’ai appuyé sur le pulvérisateur, et me voilà moi de nouveau. Cette senteur s’est déposée sur mon pull, mes cheveux, mon cou, en allumant des petites lumières dans la tête. Je suis moi, je suis là, certaines choses ne bougeront pas. L’odeur reste, et avec elle, les souvenirs qu’elle évoque. Les sentiments qui résistent, à l’appel du temps, aux vagues de la distance, aux choix de vie. C’est simplement un parfum, et finalement, c’est bien plus que ça. C’est tout ce qu’il a vécu, tout ce qu’il a fait vivre et tout ce qu’il reste à vivre.
Le goût
Dans la liste des rituels auxquels je suis attachée, il y a la tasse de café le matin. J’ai mis longtemps avant d’aimer cette boisson. Comme tout le monde, je l’ai d’abord dilué dans du lait, puis dans du lait végétal, quand j’en buvais noir, j’ajoutais un sucre. Je grimace toujours quand je prends un expresso trop serré au restaurant, ne me proposez jamais de ristretto. J’aime le café long, très long, filtre, et quand il est aromatisé, il a ce petit quelque chose, qui me séduit encore plus. À Paris, j’avais ce grand rituel, où chaque matin, je buvais mon café en tailleur sur mon canapé. Quelques fois sans rien faire d’autres, si ce n’est fixer le mur. D’autres fois une BD à la main ou mon téléphone. Si un amant restait dormir, je pouvais changer toute ma routine du matin, sauter le petit-dej, mais hors de question de partir, sans avoir eu quelques minutes, mon café, sa chaleur et moi. Mercredi matin, j’ai été tiré du lit par le jet-lag, la reine des dormeuses s’est alors réveillée tôt sans avoir aucune obligation, elle qui aime tant rester sous la couette. J’ai attendu l’heure d’ouverture du magasin d’à côté, pour acheter du café. Dans ce rayon, tout un lot de variétés et… du moulu “pécan et érable” fabriqué au Québec. Elise m’écrira quelques heures après “toujours plus toi”, et elle aura bien raison. Mais j’ai trouvé ici mon nouveau compagnon du matin : une boisson au goût doux, à faire couler dans ma tasse et à savourer, dans ce canapé bien trop difficile à quitter. J’écris ces mots, mon enceinte diffusant de la musique, mon café sur la table basse. Si je ferme les yeux, je pourrais très bien être dans mon airbnb à Bali, dans la cuisine, chez mon père ou chez ma mère, dans mon ancien appartement à Paris. Pourtant, par la fenêtre la neige virevolte dans le ciel, je suis à Montréal et ce goût, ce mélange qui risque d’en étonner plus d’un, de café-érable-pécan, sera dorénavant celui de cette aventure. Le goût d’ici.
Le toucher
Le début du confinement a fêté ses trois ans cette semaine. J’ai souri, quand j’ai pensé au nombre de câlins que j’ai fait durant mon pot de départ. J’ai pris tout le monde dans mes bras, j’ai embrassé des joues, j’ai trinqué des verres. Difficile de croire qu’il n’y a pas si longtemps, on ne pouvait plus faire tout cela. Je me serais très certainement confinée avant de partir, par peur d’attraper le Covid et de ne pas pouvoir monter dans l’avion. Au lieu de ça, j’ai touché. J’ai touché les bras de mes ami.es, je les ai pris dans mes bras. Je les ai serrés fort, si fort, pour que ma peau conserve le souvenir de la leur, pour que leurs bras enveloppent mon corps, le rassurent, lui rappellent que malgré la distance, ils ne disparaissent pas réellement. C’est ce qu’il y a de beau, avec les câlins, ils sont de véritables marqueurs d’affection. Je suis une personne à câlin, à tout moment, pour toutes les raisons. Je repense aux mots de Philosophie is Sexy :
Ceci est un trésor. Il y a cette envie soudaine de se blottir dans les bras de quelqu’un. De s’y lover. De s’y abandonner juste quelques instants. A l’abri du reste. A l’abri du flux ambiant. A l’abri de tout ce qui nous submerge. Se laisser envahir par ce sentiment de sécurité. Et relâcher son corps autant que son âme. Il existe un mot japonais pour traduire cette bulle de protection : « amae ». Même sa prononciation est déjà une ode à la douceur. L’amae n’est pas réservée aux amoureux. Elle lie tous ceux qui enfants, amis, camarades, proches ou connaissances, sont capables de s’offrir cet espace. Sans attente, sans projection, sans interprétation. Dans une indulgence absolue et un amour, qui pour une fois, est totalement acquis. Comme une confiance suprême qui nous ramène à la prime enfance. Le droit d’être vulnérable, d’avoir besoin d’affection. De peau, d’odeur, de chaleur. Le droit de ne pas se suffire à soi-même, de ne pas être autonome, mais faire de l’étreinte un refuge dans le chaos. Je vous souhaite une journée de câlins et d’amour.
Je repense à la main de mon amie adorée qui serre la mienne, pour me rassurer moi autant qu’elle. Je repense à mes bras enlacés autour de son corps à lui, pour sentir sa présence une dernière fois. Ma tête qui se dépose sur l’épaule de cet ami, cette copine qui m’a serré si fort dans ses bras, celle qui ne voulait pas partir sans une dernière accolade. Clara allongée sur le lit, son chien que j’aime tant contre mes jambes et moi, tout près d’eux deux.
J’ai acheté un pull polaire, le type de pull qui revient à la mode alors que pendant des années, on en portait seulement pour descendre les pistes de ski. Il est orangé, un peu grand, totalement doux. Je l’ai beaucoup porté ces derniers jours. Tout d’abord, parce qu’il tient chaud et ensuite, pour la sensation qu’il procure. La douceur de la polaire sur les bras, le col qui monte jusqu’au cou, la protection que cela renvoie. Il ne remplacera jamais les câlins des copains, des parents, des amours passés, mais il a l’avantage de tenir chaud, de rassurer et d’envelopper ce corps, quand il fait sentir le besoin, d’être caressé.
La vue
Je marche dans les rues, ces longues rues, interminables. Mon regard se déplace vers le ciel, mais où sont les bâtiments ? Les appartements sont bas ici, trois, quatre étages maximums. Je ne peux pas m’en empêcher, mes yeux veulent apercevoir un immeuble haussmannien. Je sais, je ne suis plus en France, ma cour de récréation a changé, pourtant je ne peux pas y déroger : chercher le familier à l’étranger. Une petite impasse, avec de beaux bâtiments ? Un boulevard bordé de grands immeubles anciens, dont la pierre raconte une histoire ? Rien de tout ça. Le paysage a changé, si le visa le prouve dans le passeport, la tête elle, a besoin de temps pour le réaliser. Par la fenêtre, le ciel. Ce n’était pas arrivé depuis longtemps. À Paris, le vis-à-vis est roi. Ici, j’ai pu apercevoir des traits roses dans le ciel hier, symbolisant le coucher du soleil. Aucun voisin à observer dans son appartement, une rue avec des arbres, des piles de neige. Au fil des balades, des dessins sur les murs à capturer, des devantures qui n’ont rien à voir avec celles d’avant, des parcs, le Mont Royal. Au loin, des buildings, “on dirait New York”, souligne l’adolescente à l’intérieur de moi. J’ai marché jusqu’au vieux port, pensant trouver l’équivalent de mes quais parisiens. Aucune péniche, mais de la glace, une grande roue qui donne envie de prendre de la hauteur, un passage qui rend impatient : vivement de découvrir tout ça avec les fleurs du printemps, la chaleur de l’été, les couleurs de l’automne.
À chaque saison son paysage, j’ai déjà hâte de voir tout ça, de revoir tout ça, de découvrir encore et encore, au fil des mois.
À la question “comment ça va ?”, j’essaie d’être le plus honnête possible. Partir, ça implique de recommencer. De rencontrer, les autres, soi-même. Ça demande du temps, pour prendre soin de sa tête, pour que son corps s’habitue, pour ne pas se brusquer. Ça fatigue aussi. Montréal, c’est très beau, les gens sont si gentils. Je suis gênée continuellement quand dans un magasin le vendeur me demande “tu vas bien ?”, après son salut. Chaque bouchée de bagel/donut/pancake/gauffre me rend un peu plus heureuse que la précédente. J’ai retrouvé mes ami.es que je n’avais pas vu depuis 9 mois/un an, il fait beau (mais froid au moment où j’écris ces mots). Je suis dubitative face au décalage horaire, et en même temps, il y a quelque choses de poétique, dans le fait de se réveiller tous les matins avec des messages de ses copines, toujours présentes malgré les 5 000 km qui nous séparent. Mais qui en doutait ? La suite, il ne reste plus qu’à l’écrire.
Bisous,
Lauréna
Merci pour ta lecture. N'hésite pas à t'abonner, à partager et retrouve-moi sur Instagram.