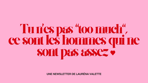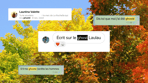Rentrer pour mieux (re)partir
ou le petit retour à la maison après neuf mois.


Lauréna in Loveland
4 min ⋅ 09/12/2023
Je ne pensais pas avoir besoin de rentrer en France pour Noël. C’est drôle, ce terme, “rentrer”. On rentre chez soi après une soirée chez des ami.e.s. On part en vacances dans un pays étranger avant de rentrer chez soi, retrouver le confort de son nid douillet. Mais comment est-ce que je peux rentrer chez moi, alors que chez moi, c’est ici ? C’est peut-être un peu toute la complexité de ces vies d’expatriés, de ces humains qui ont décidé de construire, briques après briques, une maison à eux, ailleurs. Dans un autre pays. Au Canada dans mon cas.
Je rentre constamment à la maison. La maison pourtant, ça a toujours été un concept assez abstrait pour moi. J’ai grandi entre deux maisons, entre chez maman et chez papa. Alors la maison, ça n’a jamais été un lieu. J’ai mes racines ici, entre ces murs rouges repeints de blanc lors du second confinement. Je les ai aussi là, dans cette chambre orientée plein sud, où le soleil a jauni les photos d’adolescentes qui sont restées dix ans sur les murs. Mais ça n’a continuellement été que balance. Un coup-là, un coup là-bas. J’ai construit mon chez-moi, en dehors de ces quatre murs fois deux.
La maison, c’est la plage des Orpellières à Sérignan où chaque année, pendant les fêtes, on profite d’une journée ensoleillée – ou non, pour aller marcher deux heures avec maman. Certaines fois, on parle tout du long, d’autres fois, on se contente de marcher en silence. C’est le moment où on peut se confier des choses, de celles que l’on n’ose pas dire le jour, par pudeur. Là, avec le bruit des vagues en fond, le Mistral qui fait danser nos cheveux, le soleil qui décline tout doucement derrière les Pyrénées (“si on les voit, il pleut dans trois jours”), on ose se livrer, sans crainte.
La maison, c’est le feu de cheminée. Je déplace le gros fauteuil orange pour m’installer devant. Assez éloigné, “ne te brûle pas”, répète papa, mais suffisamment proche pour poser mes pieds devant la vitre. Il crépite, la chaleur réchauffe mon corps et l’odeur m’enveloppe. Si je ferme les yeux, j’ai cinq ans. Si je les rouvre, je suis là où rien ne pourra jamais m’arriver. Je lis une BD, je travaille sur mon ordinateur, je bois une tisane ou je regarde des vidéos. Mon père passe une tête, met de la musique, ou en joue. La chaleur m’enveloppe, la musique me berce, je suis là.
La maison, c’est cette route, l’A75, qui sépare une chambre de l’autre, et l’autre de cette ville, où je suis allée au lycée. Une route longtemps associée à ces dimanches soir où ma valise et moi, changions de maison pour la semaine. Associée aux trajets en bus, qui me déposait matins et soirs au lycée. Mais cette route, c’est surtout resté celle de l’amitié. La musique est très forte dans la voiture, je monte sur la rocade en chantant trop faux trop haut trop joyeux. Je m’insère et je souris en regardant le soleil décliner dans le rétroviseur intérieur. Je n’ai même pas une vingtaine de minutes de trajet. À une époque, cela semblait énorme, mais le temps prend des proportions différentes quand tu grandis. 20 minutes, qui te séparent d’une soirée entre ami.e.s te paraissent infinies, quand des années plus tard, il s’agira de sept heures de vol (et quatre heures de train) pour les retrouver. Je sors à l’entrée de Pézenas. Il y a quelques années, elle a été limitée à 30, et une paire de ralentisseurs se sont installées. C’est long ! Encore une chanson, et bientôt, on se serrera dans les bras. On se retrouvera autour de cette table en bois dans la salle à manger. Elle nous servira un verre et on trinquera, à la vie, à celle qui défile, et au bonheur de se retrouver, une nouvelle fois. On s’installera autour de cette grande table sur laquelle sera installé un festin : tout ce qu’il faut pour faire une raclette, des fajitas, des huîtres ou que sais-je. C’est une maison, ce n’est pas la mienne, mais c’est un lieu, où on s’est toujours sentie chez soi.
La maison, ce sont les rues pavées au cœur de cette ville trop grande, dans lesquelles déambuler. Les escaliers de Bastille qui donnent sur les quais de la Rapée. Marcher au bord des péniches, en imaginant les bateaux voguer sur l’eau. Se dire que la mer est loin, mais que la Seine fait très bien office d’escapade marine. Passer sous le tunnel, bifurquer sous le métro et tourner à droite. Lever les yeux et l’apercevoir au loin, Notre-Dame. Entendre la musique de ceux qui dansent sur les quais le dimanche après-midi, regarder les amoureux se tenir la main, croiser les joggers et se dire “moi aussi, je fais(ais) ça”. C’est regarder à droite, à gauche, en l’air, le cœur battant. Repenser à toutes ces marches sur ce terrain adoré, revivre les verres qu’on a pu y boire, les ami.e.s que j’ai amené.e.s ici, expliquant “les quais sont mon jardin”. C’est là où je me rends quand j’ai besoin de souffler, de courir, de me vider l’esprit, de respirer, de marcher. Ce chemin de Bastille à Hôtel de Ville qui longe la Seine, ce sera toujours ma maison.
Il y aurait aussi le rire de cette amie, la chaleur de l’appartement de ces deux-là avec leur toutou d’amour, la Gare de Lyon, qui, qu’on le veuille ou non, sera toujours associée à cette notion de mouvement : partir, rentrer, s’évader, retrouver. Ces bras dans lesquels se lover, ces sourires infinis qui signifient l’amour, la joie des retrouvailles, la distance – qui ne s’est installée que d’un point de vue géographique, mais jamais dans les cœurs.
Je rentre à la maison. Enfin, “la”, c’est vague. Je rentre dans une de ces maisons adorées, de celle où tu peux laisser tomber à côté de tes bagages, la pression, le stress, les attentes. De celle où tu peux glisser tes pieds sous la table en face d’un bon repas, sans avoir à être, à prétendre, à tout gérer, tout assumer. Simplement, le temps de quelques jours, se laisser porter. Par l’odeur du gâteau dans le four, par le bruit des vagues, par les bras envahissants (“mais lâche-moi, je ne suis plus un bébé!!!”). Et par l’amour.
Je n’avais pas l’intention de prendre un avion pour les fêtes. Quand je suis partie, je ne pensais pas rentrer de l’année, il y a trop de choses à faire, trop de lieux à voir, trop d’espaces à découvrir. Et pourtant, un jour d’août, je me suis dit “après tout, pourquoi pas”. Ça leur fera plaisir, pensais-je. La vérité, c’est que si l’aventure est aussi belle, aussi forte, aussi prenante, c’est parce qu’il y aura toujours ces lieux qu’on appelle chez soi, à retrouver. Ces mains à serrer, ces espaces à investir, le temps de quelques jours. Respirer très fort l’air si bien connu, emmagasiner en soi, tout ce qui est là, tout ce qui existait et existera toujours. Ce qui ne bouge pas dans cette odyssée quelques fois instable, quelques fois effrayante. Garder ces petites graines près de soi, les arroser, pour qu’elles puissent continuer de germer, grandir, même une fois repartie. Vers une autre maison, vers d’autres bras à enlacer, vers d’autres tables où se retrouver. Pour toujours, plus d’aventures. Mais ailleurs.
“Ailleurs, c’est mon mot préféré du dictionnaire”, ajouterait maman.
Bisous,
Lauréna
Merci pour ta lecture ! J’espère que ces mots t’ont plu. N’hésite pas à me faire part de ton retour, à t’abonner, à partager, que sais-je. On se retrouve sur Instagram !