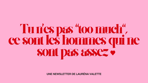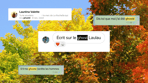L’inspectrice des travaux finis
ou mes pensées en bord de mer.


Lauréna in Loveland
8 min ⋅ 05/12/2022
J’ai passé la semaine dans le sud. C’est l’avantage de cette période d’entre deux vies : je n’ai plus d’obligation professionnelle qui me lie à Paris, je peux voguer ici et là, comme bon me semble. Alors, je suis rentrée à la maison, celle de mes parents, pour profiter du soleil, voir la mer, passer du temps avec mes copines et ma famille. Faire un break de la vie parisienne, laisser quelques jours me séparer de cette bulle d’hyperactivité, suffisamment pour avoir hâte, de la retrouver.
À Montpellier, Mélanie m’a amené bruncher dans un restaurant où on peut commander des gaufres au saumon et à l’avocat, boire des smoothies, le tout avec option vegan. Assise en terrasse, à regarder ce lieu avec attention, j’ai réalisé que c’était l’ancien Scarabée. Feu le bar où on buvait des shooters le mardi soir (mais aussi le mercredi, le jeudi, le vendredi…) en deuxième année. Mélanie a sorti son téléphone, elle était sûre d’avoir toujours des photos d’une de ces soirées avec les copines. Bingo, les voilà : mes amies, celles que je connais depuis 10 ans maintenant, avec leur visage de 19 ans, au comptoir du Scarabée. Ce bar où on pouvait écrire sur les murs et les tables avec des Posca, dans lequel on allait à deux (si ce n’est trois) aux toilettes. Celui où l’une de nous était suffisamment proche du barman pour pouvoir gérer la musique. Un tout petit bar, comme il y en a tant d’autres à Montpellier, qui a été témoin, le temps de quelques nuits, de notre passage, de nos éclats de rire, de nos ivresses, de ces années étudiantes durant lesquelles on a commencé à avancer, un pas après l’autre, dans la vie. Quelques fois en se bousculant, d’autres fois en trébuchant, mais déjà, encore, toujours, les unes aux côtés des autres.
En marchant, on est passé devant le Cubanito. Il n’a pas changé. Quiconque lit ces lignes et a vécu un tant soit peu à Montpellier, connaît certainement ce bar. Solène m’a raconté : “c’est normal s’il existe encore, c’est un des rares bars dansants de la ville”. On dansait au Cubanito ? Dans mes souvenirs, on squattait la terrasse même par 5 degrés. On s’asseyait collées les unes aux autres et on buvait des cocktails beaucoup trop sucrés. Si je me rappelle bien, on se rendait dans ce bar dansant, pour profiter des réductions obtenues par notre BDE. À 18 ans, je préférais les cocktails-pas-ouf, mais à 4 € aux pintes de bières parisiennes IPA vegan bio brassée dans le 11e, à 10 €. On se demande bien pourquoi.
Alors le Cubanito existe toujours. Je m’interroge sur les personnes qui squattent sa terrasse peu importe le jour de la semaine ou la météo. Je ne me souviens plus vraiment de mes pas de danse dans ce bar, mais j’ai gardé en mémoire cette fois où j’ai dansé collé-serré avec mon crush de la bibliothèque universitaire. J’étais timide comme tout en première année de fac, néanmoins, j’avais complètement craqué pour ce brun aux yeux bleus et au sourire ravageur. Une après-midi, on faisait une pause-café devant la BU, avec Mary, mon acolyte de la fac, et il était venu nous parler. Il avait trouvé une excuse, et on était resté comme ça, au milieu de l’université, à faire connaissance durant pratiquement 2 heures. Plus tard, par message, je lui avais proposé de venir boire un verre avec nous, car déjà à 18 ans, toutes les occasions étaient bonnes pour se retrouver en terrasse. C’est comme ça qu’un mardi soir, on a dansé au Cubanito (et on s’est embrassé aussi). Est-ce qu’aujourd’hui encore, les L1 de Paul Valery embrassent leur crush de la bibliothèque universitaire au Cubanito ?
Lundi, j'ai pris la voiture pour me rendre chez ma tante à Sète. Durant tout le trajet, j’ai écouté le dernier album de Taylor Swift. J’adore ces petites actions anodines, qui m’emplissent systématiquement de joie. Il y a notamment ce moment, où après une longue journée, je me glisse dans des draps propres, fraîchement lavés. Également, les trajets en voiture, quand je suis au volant et que je chante à tue-tête, le soleil réchauffant mes bras et les vignes, comme seul paysage. Lundi matin, c’était un peu comme ça.
Je suis passée par Montagnac pour rejoindre Sète, et le GPS m’a indiqué de tourner à droite au rond-point. J’ai hésité, dans mes souvenirs, on continuait tout droit, mais je ne vis plus ici, je peux me tromper. En tournant à droite, j’ai compris que cette route était nouvelle. Il y a encore quelque temps, elle n’existait pas. À l’époque, on traversait le village. Il y avait un feu tricolore au milieu de celui-ci, on s’y arrêtait systématiquement. Qu’est-ce que c’était long de traverser Montagnac ! Maintenant, il y a une rocade. Dans la voiture, j’ai exprimé ma surprise “non mais c’est fou ! Ça a encore changé. Mais ces routes, je les prends quoi, tous les 5/6 mois et à chaque fois, il y a des nouveautés.”. J’ai une très bonne mémoire visuelle, si je retiens les visages, cela fonctionne aussi pour les routes et les panneaux. Quand quelque chose change, quand une route est construite, un panneau ajouté, un bar remplacé par un restaurant de brunch, ça allume une petite veilleuse dans ma tête. Je me transforme alors en inspectrice des travaux finis, j’observe tout et je donne mon avis : qu’est-ce qui a encore été modifié ? Pourquoi faut-il toujours tout changer ? Demande celle qui bouleverse, actuellement, tout son quotidien.
À Sète, je suis allée à la piscine. Qui avait, bien évidemment, était rénovée. Mes parents m’y amenaient quand j’étais enfant, car il y a un toboggan. Lui, il n’a pas bougé, si ce n’est que sa couleur rouge criarde a été remplacée par une peinture blanche. Il descend toujours en tourbillon jusqu’au bassin des enfants. Ouf, ces derniers ne seront pas privés de ce jeu merveilleux qui nous obligeait à attendre en grelottant dans les escaliers, que les autres soient descendus, pour pouvoir vivre quelques secondes d’extase, de sensation forte, de “youhouuu maman regarde comme ça va vite !”.
Mais cette semaine, je n’ai pas fait qu’observer les changements et nager à la piscine, j’ai aussi travaillé (oui ça y est, je travaille un peu, enfin !) et j’ai profité de la mer. Je l’aime bien, cette période d’entre deux vies, quand elle se passe au soleil et au bord de l’eau. Assise sur un rocher, j’ai pris quelques notes pour cette newsletter et j’ai commencé à réfléchir à cette notion de travaux, qui semble ne jamais quitter la vie des personnes qui m’entourent.
Mon père a installé des miroirs dans le salon de ma tante. Chez lui, il m’a montré les différents travaux qu’il a effectués : installer des étagères, rénover un placard, enlever le meuble du salon pour le mettre dans le garde-manger… Ma mère, chez elle, a récemment remplacé les interrupteurs de la salle de bain.
Est-ce qu’un jour, on arrête de faire des travaux, des petits arrangements, ou est-ce que c’est comme ça toute notre vie ?
Est-ce qu’on finit par lâcher le tournevis pour de bon, ou une nouvelle action vient s’ajouter à la liste ? Continue-t-on, indéfiniment, de changer des interrupteurs, remplacer le meuble du salon, installer de nouveaux miroirs ? Et ces interrogations ne concernent pas que les maisons, après le restaurant de brunch, il y aura peut-être un magasin de vinyle. La route de Montagnac, sera peut-être modifiée une nouvelle fois ces prochaines années. Et le Cubanito, sera-t-il encore le théâtre des émois des premières années en quête d’identité, qui ne peuvent pas s’offrir mieux qu’un cocktail à 4 €, quand je reviendrai ? Ou deviendra-t-il un énième restaurant de wok, poké bowl ou kebab, si fidèle à ce quartier ?
“Termine-t-on un jour de tout construire ?”, voilà ce que j’ai écrit, depuis mon rocher au bord de la plage. Est-ce que toutes ces briques que je place, jour après jour, depuis maintenant plusieurs années, seront, un jour, stables, ou ne sont-elles là que pour être modifiées, arrangées, déplacées, rénovées… Quand on sait qu’on va devoir tout reconstruire, ici ou là-bas, peut-on vraiment envisager la fin des travaux ?
Cette semaine, j’ai beaucoup parlé à mes parents d’après. Je ne suis pas encore partie au Canada, pourtant j’évoque sans cesse ce que je ferai après. Quand je reviendrai. Je leur ai fait part de mon envie de revenir à Paris, parce que c’est ma maison. Mes envies professionnelles, pour après. Après, après, après, mais après quoi exactement ? J’évoque un futur incertain, dans potentiellement deux ans, sans même avoir la moindre idée, de ce qui m’attend pour les trois prochains mois, les prochaines saisons là-bas. Je suis incapable de prendre le temps et de vivre dans l’instant. Je n’arrête pas d’imaginer la fin des travaux, le nouveau pont qui sera construit sur la route, les nouveaux restaurants qui prendront place sur mes anciens territoires. Je n’arrive pas à lâcher prise et à accepter, que toutes ces choses, tous ces lieux, toutes ces personnes, toute cette vie, peut prendre une autre forme, un nouveau chemin. Et pour la voir, pour le découvrir, il faut simplement lâcher la pédale d’accélération, rétrograder et… prendre le temps. Arrêter de courir après un futur qui n’est pas encore écrit, cesser de garder un œil sur un passé qui s’est éloigné et se concentrer sur : maintenant. Inspecter les travaux en cours et peut-être même, prendre plaisir à y participer, un tournevis dans une main et un marteau dans l’autre.
Bisous,
Lauréna
Billet publié initialement le 27 novembre 2022.
Merci pour ta lecture. N'hésite pas à t'abonner et retrouve-moi sur Instagram.